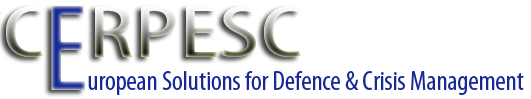You are here
Feed aggregator
L’État-major burkinabé frappé, le G5 Sahel visé, le GSIM revendique
(B2) La double attaque contre l’État-major burkinabé et l’ambassade de France à Ouagadougou (Burkina Faso), vendredi, a été revendiquée par le groupe extrémiste GSIM. Au-delà des mots, il semble bien que ce soit le G5 Sahel qui ait été aussi (et surtout ?) visé.
Une attaque rapidement contrée par les forces burkinabèses et françaises
L’attaque, vendredi (2 mars), d’abord de l’ambassade de France à Ouagadougou puis de l’état-major des forces armées du Burkina Faso, semblait surtout viser le G5 Sahel. Une réunion de l’état-major du G5 Sahel était en effet prévue vendredi (2 mars). Et ce n’est qu’au dernier moment qu’elle a été déplacée. Le bilan important — 7 militaires burkinabès tués et environ 70 blessés dont une douzaine dans un état critique — aurait donc pu être encore plus lourd (1).
Une rapide réaction coordonnée française et burkinabèse
« Les unités spéciales des forces de défense et de sécurité burkinabés, avec l’appui des militaires français chargés de la sécurité de l’ambassade, ont rapidement neutralisé les assaillants » souligne-t-on à l’état-major français. « Un détachement des forces françaises présentes à Ouagadougou » est intervenu également, « immédiatement, à la demande des autorités locales » pour participer à la sécurisation des deux sites et assurer la sécurité des ressortissants français.
Une attaque en réponse à un raid contre le Mali
L’attaque a été revendiquée par le groupe jihadiste GSIM (Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans) dès le lendemain (3 mars). Elle aurait été menée « en réponse à la mort de plusieurs de ses dirigeants dans un raid de l’armée française dans le nord du Mali il y a deux semaines » affirme-t-il dans un communiqué rapporté par l’agence privée mauritanienne Al Akhbar et l’AFP.
Les forces françaises avaient en effet mené une importante opération terrestre et aérienne contre le GSIM dans le nord-est du Mali le 15 février, à la limite de la frontière algérienne, neutralisant une vingtaine de jihadistes, capturés ou tués (lire : Mali. Les Français mènent un raid héliporté près de la frontière algérienne).
La France, cible des groupes terroristes
Il ne s’agit pas de la première attaque revendiquée par le GSIM contre les Français. Le 21 février dernier, une attaque avait entrainé la mort de deux soldats français. (Lire : Deux militaires de Barkhane tués au combat au Mali). Le Touareg malien Iyad Ag Ghaly est activement recherché par les forces françaises.
Mais au-delà des Français, cela semble être surtout les responsables du G5 Sahel qui étaient visés. Les attaquants semblaient apparemment avoir été bien informés. Car une réunion de l’état-major du G5 Sahel devait se tenir le jour même. Le président nigérien Issoufou Mahamadou, a ainsi « salu[é] la réaction énergique et salvatrice des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et des pays alliés ». Il a appelé cependant à « la vigilance accrue dans tous les États » du G5 Sahel. A travers l’État-major burkinabé, ce sont, en fait, les Forces du G5 Sahel qui étaient visées. Pour le Nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice du G5 Sahel, c’est clair. Celui-ci a d’ailleurs « réaffirm[é] son engagement à tout mettre en œuvre en vue de consolider et de faire fonctionner la synergie opérationnelle entre les forces de défense et de sécurité des États membres du G5 Sahel, leurs alliés et l’ensemble de la communauté internationale ».
…mais préparé
Le G5 Sahel est conscient du risque couru et appelle à un financement rapide. « Maintenant les groupes armées savent que la force est en préparation et pratiquement, nous affrontons une course contre la montre. Je m’attends à une accélération des attaques. Ils vont essayer de mettre la pression. mais les forces nationales et internationales sont très activent. Il faut que la logistique suive le plus rapidement possible. Il faut être très pragmatiques et pratiques », avait affirmé Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, lors du point de presse suivant la Conférence des donateurs pour le G5 Sahel, le vendredi 23 février (Lire : Le G5 Sahel demande un financement permanent pour sa Force conjointe)
(Claire Boutry, avec Leonor Hubaut et AFP)
(1) Neuf des assaillants (et non huit comme initialement annoncés) ont également été tués au cours de l’attaque. Aucun ressortissant français n’a été tué ou blessé selon le ministère français des Affaires étrangères.
Le protectionnisme en matière de défense ? Les Etats-Unis le pratiquent avec talent… et efficacité
Un premier convoi de secours pour la Ghouta orientale… Ce n’est pas suffisant dit le CICR
(B2) Après avoir tenté à de multiples reprises d’obtenir un accès humanitaire à la Ghouta orientale au cours des dernières semaines, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a finalement pu entrer dans la ville de Douma en début de journée lundi (5 mars), dans le cadre d’un convoi humanitaire organisé conjointement avec le Croissant-Rouge arabe syrien et les Nations Unies, annonce l’organisation humanitaire dans un communiqué parvenu à B2.
Un convoi de 46 camions
Le convoi de 46 camions transportait 5 500 colis alimentaires pour un mois destinés à plus de 27 500 personnes (un colis par famille de cinq), ainsi que des fournitures médicales et chirurgicales vitales comme du matériel de pansement. « Ce convoi constitue un premier pas positif qui atténuera dans l’immédiat les souffrances d’une partie des civils dans la région de la Ghouta orientale. Mais un seul convoi, aussi important soit-il, ne suffira jamais compte tenu des conditions désastreuses et des pénuries auxquelles la population est confrontée. Un accès humanitaire constant doit impérativement être garanti et davantage d’autorisations doivent être accordées dans les jours et les semaines à venir », insiste Robert Mardini, directeur du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient.
Une situation inacceptable
Le CICR n’avait plus pu fournir d’aide humanitaire dans la Ghouta orientale depuis le 12 novembre dernier (lire : La situation dans la Ghouta orientale inquiète les ONG). « Depuis quelques semaines, de nombreux habitants de la Ghouta orientale sont morts dans les combats intenses ou faute d’accès aux soins médicaux. Cherchant à se protéger des bombardements continus, des familles ont passé des jours et des nuits cachées dans des abris souterrains, avec presque rien à manger. Des hôpitaux, des maisons et des installations du Croissant-Rouge arabe syrien ont été endommagés et continuent d’être pris pour cible ». « Cette situation est inacceptable » précise l’organisation.
Les règles minimales du droit de la guerre bafouées
La ville de Damas n’est pas épargnée. « De nombreux quartiers ont essuyé des tirs de mortiers ces dernières semaines, faisant des morts et des blessés parmi les civils. » Le CICR a demandé « à maintes reprises à tous les acteurs en Syrie de respecter le droit de la guerre, qui est actuellement ignoré ». Et l’organisation de lancer un nouvel appel, implorant chacun d’avoir un minimum d’humanité. « Nous exhortons une fois encore les parties au conflit à prendre toutes les précautions possibles pour épargner et protéger les civils ».
(NGV)
Carnet (05.03.2018). COPS (Agenda). PESCO (observateurs, pays tiers). US-UE-Agence (gel). Ukraine (détournements de fonds). Opération Sophia (cellule renseignement, Slovénie). France (avion Epicure). EDIDP (plénière, projets, texte). Investissements...
« C’est la première LPM dans laquelle l’armée de terre se retrouve »
La mission EUTM RCA bientôt déployée à l’extérieur de Bangui. Les pistes de la ‘review’
En Méditerranée, Sophia (UE) et Sea Guardian (OTAN) se parlent
La frégate espagnole ESPS Navarra (F-85), la frégate italienne Euro (F-575) et la frégate belge Louise Marie (F-931) en patrouille en Méditerranée (crédit : OTAN/Marcom)
(B2) Francisco Javier Vázquez Sanz, le commandant du groupe opérationnel pour l’opération Sea Guardian de l’OTAN a rendu visite au contre-amiral italien Alberto Maffeis, le commandant de la force maritime de l’UE EUNAVFOR Med, à bord du navire amiral ITS San Giusto de l’opération Sophia, le 24 février dernier. Objet de la rencontre : discuter de la coordination au niveau tactique et du partage de l’information dans la Méditerranée centrale. Ils ont ainsi parlé, « des options visant à renforcer les liens et les réseaux de partage d’informations qui soutiennent à la fois l’opération Sea Guardian et l’opération Sophia ».
Un objectif : le recueil d’information
L’opération Sea Guardian a, en effet, un objectif principal : « recueillir des informations et surveiller les business model afin de détecter les activités suspectes en mer ». L’OTAN et l’UE échangent « quotidiennement des rapports de situation et des projets de navigation, ainsi que les calendriers d’opérations aériennes, de surface et sous-marines ». Ce partage des informations « permet d’éviter les doubles emplois dans les tâches [comme] de dresser un tableau plus large des activités maritimes en Méditerranée centrale ». Cet échange continu d’informations et la coordination permettent « d’accroître l’efficacité de l’opération ainsi que la couverture du territoire », indique le communiqué de l’OTAN.
Malgré deux chaînes hiérarchiques différentes…
L’information recueillie par les navires de l’OTAN est communiquée au QG de l’OTAN, au commandement maritime allié (Marcom pour les intimes) situé à Northwood, près de Londres. Après avoir été « compilée et traitée », elle est « partagée entre les marines alliées et partenaires » comme avec les navires de l’opération Sophia de l’Union européenne.
De son côté, l’information recueillie par les navires de Sophia remontent au QG d’opération situé à Rome (dans l’enceinte du QG de la marine italienne), puis à Bruxelles à l’état-major de l’UE, où il est normalement partagé entre tous les États membres (via des rapports réguliers d’opération). NB : Dans les faits, un premier partage et une diffusion de l’information est faite entre les principales nations participant à l’opération EUNAVFOR Med.
… une certaine bonne coordination
La présence dans les deux opérations de navires italien et espagnol participent ainsi de la bonne coopération entre les deux organisations. Elle rend « les échanges plus fluides » comme l’a confirmé à B2 un officier. L’échange d’informations qui ne peut être fait officiellement ou directement entre les deux organisations (du fait de la divergence sur Chypre et la Turquie), se réalise en fait via les forces participantes, notamment italiennes ou espagnoles, qui centralisent ainsi une bonne part de l’information recueillie, chacune pour la zone les concernant.
Un champ d’investigation différent
Malgré une similitude apparente, il reste de singulières différences entre les deux opérations. Le champ de surveillance des navires de l’OTAN est ainsi un peu plus large que celui de l’opération Sophia puisqu’il s’étend jusqu’à l’Espagne. Les navires, aéronefs et sous-marins de l’OTAN effectuent des patrouilles « ciblées dans le centre et l’ouest de la Méditerranée », là où l’opération Sophia se concentre normalement sur la Méditerranée centrale. Son objectif est aussi largement différent. Les navires de l’OTAN, même si cela n’est pas indiqué publiquement, ont aussi pour fonction de surveiller les navires de puissance étrangère (russes par exemple) qui se trouvent dans les parages.
Un fonctionnement légèrement différent
Le fonctionnement des deux missions est aussi légèrement différent. La mission Sea Guardian en Méditerranée est intermittente, de l’ordre de quelques semaines par trimestre, là où l’opération européenne est présente en permanence sur la zone 24h sur 24. La période actuelle est ainsi limitée, entre le 12 février et le 4 mars, pour Sea Guardian.
Pas d’intervention au titre du chapitre VII
La mission Sea Guardian n’est pas basée sur le principe de solidarité (le fameux article 5 du Traité de l’Atlantique Nord). Elle se veut plutôt « une réponse à l’évolution de l’environnement de sécurité maritime en Méditerranée ». Elle ne bénéficie spécifiquement pas d’une autorisation d’intervention par la force au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, contrairement à l’opération européenne Sophia qui a reçu mandat en ce sens (au titre de la résolution 2240 adoptée le 9 octobre 2015). Mais elle peut intervenir, comme tout navire d’un pays membre de l’ONU, pour faire respecter l’embargo sur les armes à destination de la Libye mis en place en 2011 (3).
(Nicolas Gros-Verheyde)
(1) Le quartier général de Marcom est ainsi basé dans la même enceinte que le QG de l’opération européenne anti-piraterie EUNAVFOR Atalanta.
(2) Elle regroupe des forces variables selon les moments, essentiellement fournies par les pays côtiers — un navire italien et un navire espagnol en ce moment, renforcés par un navire belge. La frégate espagnole ESPS Navarra (F-85), qui assume le rôle de navire-amiral, la frégate italienne Euro de la classe Maestrale (F-575), la frégate belge Louise Marie (F-931).
(3) Résolution 1970 du Conseil de sécurité du 26 février 2011, prolongée régulièrement depuis.
(crédit photo : Marcom / OTAN)
Un sous marin grec dans Sophia
(B2) Un sous-marin grec, le Pipinos (S-121), a participé à l’opération maritime européenne en Méditerranée (EUNAVFOR Med / Sophia) apprend-on.
Durant deux semaines, du 14 au 28 février, il a pu observer discrètement les mouvements de certains navires, notamment afin d’appliquer la résolution de l’ONU sur l’embargo sur les armes en Libye.
Le Pipinos est le deuxième sous-marin de classe Papanikolis de conception allemande de Type 214 de la marine grecque.
(NGV)
crédit : marine grecque
La Pologne s’engage dans l’opération Sophia en Méditerranée
(B2) Un nouveau détachement aérien a rejoint l’opération EUNAVFOR Med Sophia. Une unité polonaise, a été intégrée jeudi (1er mars), sur la base aérienne de Sigonella (en Sicile).
Le ‘White Lady’ au-dessus de la Méditerranée
Elle est composée d’un avion Antonov AN-28 B1R (ou M28 Bryza), le n° 1017 dit ‘White Lady‘ provenant de la 44ème base aérienne de Siemirowice, et de 100 militaires. Des hommes qui viennent essentiellement de la brigade aéro-navale (Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej) et d’autres éléments (3e flottille, 6e centre radio-électronique, inspection des forces armées de soutien, 10e brigade logistique, 9e brigade de soutien au commandement, commandement de la composante des forces spéciales et police militaire).
Première participation à une opération maritime de l’UE
C’est la première fois que la Pologne fournit une contribution à l’opération maritime européenne lancée en 2015 pour lutter contre les trafics en Méditerranée centrale, et même la première fois tout court qu’elle participe aux opérations maritimes de l’UE (contre la piraterie par exemple).
Plusieurs mois avant
Une reconnaissance de la base de Sigonella a eu lieu en octobre 2017 et janvier 2018. Dans le même temps, le contingent formé se préparait à l’exercice de certification effectué par le commandement opérationnel fin janvier, selon le communiqué du ministère. Un détachement précurseur s’est déployé le 6 février.
Lutter contre les trafics de migrants
Cet engagement a été décidé par l’ancien gouvernement et approuvé par le président polonais, Andrzej Duda, le 31 janvier. Une décision qui semble répondre à une double motivation : prouver que la Pologne s’engage aux côtés des autres pays dans la lutte contre les trafics de migrants (1), notamment de l’Italie, souligner la volonté de Varsovie de respecter les engagements de la Coopération structurée permanente.
L’expression de notre solidarité
« C’est une mission qui montre notre solidarité avec nos partenaires de l’UE et qui nous apportera des résultats positifs, car elle augmente la sécurité » a souligné le ministre de la Défense, Mariusz Błaszczak, le 12 février dernier, lors de la cérémonie de départ. « Il est très important que l’armée polonaise participe à cette mission, afin que nous combattons ensemble ce conflit, car il ne fait aucun doute que la crise migratoire est la base d’un conflit qui nous apporte une moisson sanglante en Europe. »
(Nicolas Gros-Verheyde)
(1) Cet engagement s’inscrit dans le bras de fer entamé entre les pays de Visegrad (dont la Pologne) sur la relocalisation contre Bruxelles. Un petit détachement polonais est aussi présent à la frontière entre la Macédoine et la Serbie.
Acier. L’Europe ne restera pas les bras croisés face aux menaces de Donald Trump (V2)
(B2 avec AFP) L’Union européenne prépare des mesures de rétorsion sur des entreprises et marques américaines dont « Harley-Davidson, le Bourbon et Levi’s », a précisé le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker vendredi à Hambourg devant des journalistes de la télévision allemande.
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi soir son intention d’imposer la semaine prochaine des droits de douane de 25% pour l’acier et de 10% pour l’aluminium sur les importations aux États-Unis afin de protéger l’industrie sidérurgique nationale, sans toutefois dire quels pays seraient visés.
Nous ne serons pas naïfs
Dès l’annonce de cette décision, le président de la Commission européenne a exprimé ses « regrets » et promis que l’UE allait « réagir fermement et proportionnellement pour défendre (ses) intérêts ». Vendredi, il a répété cette détermination. « Nous ne resterons pas les bras croisés lorsque l’industrie et les emplois européens seront menacés » a-t-il averti.
« L’Europe devra s’opposer à ce projet. Nous nous défendons et imposons des droits d’importation sur Harley Davidson, Levi’s et Bourbon. »
Si les Etats-Unis veulent instaurer des barrières, « nous serons aussi stupides » qu’eux, a-t-il ajouté ensuite. « L‘Europe a besoin d’une politique commerciale capable de se défendre: nous ne serons pas naïfs ».
.@JunckerEU #Matthiaemahl: “Bedauerlich, dass #Trump Zölle auf Stahl und Aluminium erheben möchte. #Europa wird sich gegen dieses Vorhaben stellen müssen. Wir wehren uns und verhängen jetzt auch Importzölle auf Harley Davidson, Levi‘s und Bourbon.” pic.twitter.com/QBU2Ku5N3L
— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 2 mars 2018
Une fenêtre d’opportunité avant les répliques commerciales
Un peu plus tôt vendredi (2 mars), le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, avait néanmoins estimé auprès de l’AFP qu’il restait « une fenêtre d’opportunité » afin d’éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Il a expliqué que ces contre-mesures européennes, déjà « prêtes depuis un certain temps », seraient en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qu’elles compenseraient en valeur les pertes potentielles pour l’industrie européenne, deuxième producteur mondial d’acier après la Chine.
NB : Les États-Unis importent 30 millions de tonnes d’acier par an, pour une valeur de 24 milliards de dollars, et sont de ce fait le plus gros importateur au monde, selon des données du ministère allemand de l’Économie. Quelque 4% de cet acier sont importés d’Allemagne et 50% viennent de quatre pays: Canada, Brésil, Corée du Sud et Mexique.
L’Union doit réagir
« Imposer des tarifs punitifs sur l’acier et l’aluminium n’est rien d’autre qu’un protectionnisme nationaliste » a déclaré l’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, chef du groupe libéral et démocrate au Parlement européen, sur twitter. « « America First » ne signifie pas que vous pouvez miner le droit commercial international. L’UE doit réagir rapidement et conformément aux règles de l’OMC pour défendre ses intérêts. »
(NGV avec AFP)
Crédit photo : Commission européenne
La feuille de route de la PESCO : un cycle biannuel de réunions pour mieux préparer les projets
Le contenu terroriste doit être retiré dans l’heure. La recommandation de la Commission
Carnet (02.03.2018). EULEX Kosovo (réduction). Cops (agenda). Union africaine (soutien). Ukraine (force de paix). Italie (armée de terre). Naval group (résultats). Ukraine-USA (armes). Bosnie-Herzégovine (Juncker). Ukraine (gaz). TPIY (suivi). Mali ...
Un parachutiste nommé chef d’Etat major
La BEI et l’Agence européenne de défense veulent mieux coopérer… sur les biens de double usage uniquement !
Les Européens dépensent-ils plus pour leur défense. Et mieux ? Six observations
(B2) Nous avons effectué une lecture attentive des dernières statistiques produites par l’Agence européenne de défense. Même si elles ne concernent que les années 2015 et 2016, elles sont intéressantes. Voici quelques leçons qu’on peut en tirer, qui diffèrent sensiblement de l’ambiance officielle, toujours propice à l’optimisme.
Première leçon : Un déficit de presque 20 milliards par rapport à 2005
Malgré une remontée nette des dépenses de défense, les pays européens n’ont pas encore vraiment rattrapé les six années de restriction (2008-2013). Et ces chiffres doivent être pris avec beaucoup précaution, car ils se basent souvent sur les chiffres courants (hors inflation) et ne prennent pas en compte les élargissements. Si on tient compte des chiffres réels, la montée est moins rapide. Le déficit est encore de 18,4 milliards en 2016 par rapport aux chiffres de 2005.
Deuxième leçon : Une chute notable du poids de la défense dans le PIB en dix ans
Alors qu’en 2006, les Européens dépensaient 1,8% de leur PIB pour la défense, ce chiffre n’atteint en 2016 que 1,43%. Malgré toutes les augmentations de budget, et au coup de clairon entamé par les autorités otaniennes, il reste quasi stable durant les trois dernières années. Cela tient à deux éléments : certains grands pays n’augmentent que faiblement leur budget de défense, mais surtout l’augmentation de la croissance a annulé les gains de l’augmentation. Cela signifie que les Européens ont stabilisé la baisse mais qu’ils ne parviennent pas encore à récupérer les coupes franches réalisées dans les dernières années.
Troisième leçon : La défense variable d’ajustement des dépenses publiques
Représentant presque 4% des dépenses publiques en 2005 (3,88%), les dépenses de défense sont passées à presque 3% en 2014 (2,97%) pour remonter légèrement en 2016 au-dessus de la barre des 3% (à 3,08%). Cette baisse confirme une impression ressentie dans nombre d’armées : dans l’effort des restrictions budgétaires, la défense a assuré davantage que sa part de l’effort.
Quatrième leçon : Une atonie de l’engagement extérieur
Le nombre de soldats déployés est en diminution constante. Il est aujourd’hui de 32.000, le chiffre le plus faible depuis dix ans (et de loin) ! Idem pour le coût en opérations qui a diminué de façon considérable, en quelques années : 5,3 milliards en 2016. C’est moitié moins que le pic de 2011 mais aussi au-dessous du montant de 6,7 milliards d’euros en 2006, avant le surge en Irak puis en Afghanistan et les grosses opérations de la PSDC en 2008-2009, et la crise financière.
Cinquième leçon : La faiblesse des investissements en recherche
Les dépenses de recherche et technologie (R&T) ont diminué régulièrement de 2006 à 2016, passant de 2,7 milliards d’euros à 2,1 ou 2,2 milliards d’euros, selon les années. Elle atteignent ainsi péniblement des taux de 1,06% (2015) et 1,0% (2016) des dépenses de défense contre 1,32% en 2006. Soit la moitié de l’objectif fixé. C’est insuffisant pour faire la différence.
Sixième leçon : Face à la crise financière le repli
Les différents ‘benchmarks‘ (objectifs) fixés par l’Union européenne ne sont pas atteints, particulièrement en matière de travail en commun. Les marchés publics passés en commun atteignent péniblement 16% en 2015 contre près de 21% en 2006, soit environ la moitié de l’objectif fixé (35%). La recherche et technologie (R&T) assurée en mode collaboratif a baissé également, passant de 16,6% en 2008 (le pic le plus haut) à 7,2% des dépenses de R&T en 2015, loin de l’objectif des 20%.
Le travail en commun n’est donc non seulement pas développé, mais il régresse. Cela confirme que face à la crise financière, les États ont préféré assurer leurs appels d’offres en solo – leur permettant à la fois d’avoir une maitrise du calendrier, des spécifications… et du bénéficiaire final – que de recourir à des appels en commun, plus lourds à mettre en œuvre et plus risqués en termes de retour.
(Nicolas Gros-Verheyde)
En savoir plus, lire notre analyse complète sur B2 pro : Défense, Opex, Recherche… Combien l’Europe investit ? Les chiffres 2015 et 2016 analysés
Crédit photo : ministère de la Défense de Bulgarie – mai 2013
Service national universel: grand flou et « fête du slip »
Une infiltration jusqu’au coeur de l’Etat slovaque, l’enquête inachevée de Jan Kuciak (V2)
(B2) Jan Kuciak enquêtait bien sur un sujet chaud : la présence et l’infiltration de la mafia italienne, en particulier calabraise (la ‘Ndrangheta), dans l’économie slovaque et jusqu’à un certain niveau de l’État. Le quotidien en ligne Aktuality, auquel il appartenait, a publié les premiers éléments de l’enquête, schéma à l’appui, sur lequel travaillait le jeune journaliste, assassiné la semaine dernière dans sa maison à quelques 60 km de Bratislava (lire : Ján Kuciak assassiné par qui ? pour quoi ?). L’article même inachevé est éloquent… et inquiétant.
Qu’apprend-on ?
Plusieurs personnages, ayant des liens avec la mafia italienne — Carmine Cinnante, Antonino Vadala —, sont venus se réfugier en Slovaquie pour échapper à des procès ou des condamnations en Italie. Ils ont fait des affaires, ont reçu des subventions, notamment européennes et, surtout, établi des relations avec des personnes influentes au plan politique notamment dans le bureau du gouvernement.
Des millions de subventions européennes
Ces hommes gèrent des centaines à des milliers d’hectares de terres, et à ce titre reçoivent des subventions européennes. Pour les seules années 2015 et 2016, leurs entreprises ont réussi à obtenir plus de huit millions d’euros de paiements directs de l’agence des paiements agricoles, indique Aktuality. Vadala crée ainsi des entreprises à tour de bras, notamment GIA management avec Mária Trošková. Il a également comme partenaire commercial, Viliam Jasaň.
Une infiltration jusqu’au cœur de la sécurité de l’État ?
Deux personnages qu’on retrouve… au sommet de l’État. Mária Trošková est conseillère du Premier ministre Robert Fico. Elle est par ailleurs chef de cabinet de Viliam Jasaň, qui est le directeur de bureau du Conseil de sécurité de l’État ou Bezpečnostnej rady štátu (BR SR). Un organe, consultatif, qui a un rôle primordial dans la sécurité de la République slovaque. Présidé par le Premier ministre Robert Fico, il comprend les principaux ministres concernés par un problème de sécurité (Intérieur, Défense, Finances, Affaires étrangères, Économie, Justice, Transports, Santé).
Un organisme au courant de tous les secrets défense … et de l’OTAN ?
Il a pour rôle d’évaluer la situation de la sécurité en République slovaque et dans le monde. Il prépare des propositions de mesures gouvernementales sur la prévention des crises. Autrement dit, il peut accéder à certains documents d’analyses des services, classés « secret défense ». Son programme de travail 2018 prévoit ainsi qu’il soit informé des différents exercices de crise de l’OTAN (comme l’exercice de gestion de crises CMX 17), de l’état de la sûreté nucléaire, de l’approvisionnement en énergie ou alimentaire, du nombre de soldats employés, de leur répartition, de leurs équipements et des installations des forces armées, etc.
Les deux individus ont annoncé ce mercredi (28 février) leur intention de démissionner mais ont dit « rejeter catégoriquement tout lien avec cette tragédie. Nos noms ont été abusés dans la lutte politique contre le Premier ministre Robert Fico ».
(Nicolas Gros-Verheyde)
Une demande d’information envoyée aux autorités slovaques
Interrogé lors du point de presse quotidien, ce jeudi 1er mars, le porte parole de la Commission, a rappelé que « les États membres (étaient) les principaux responsables de la gestion juridique des fonds européens ». L’exécutif européen a ainsi envoyé « une lettre à l’autorité compétente en Slovaquie pour demander des informations sur l’utilisation abusive possible des fonds agricoles » a-t-il ajouté. La Commission n’a « aucune tolérance pour la fraude avec les fonds européens. Et nous insistons par conséquent sur un engagement clair de tous les États membres pour prévenir la fraude ». (CB/ES)
Pages