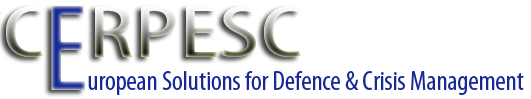You are here
Feed aggregator
Jerusalem pomme de discorde
Entre l’OTAN et l’UE, les sourires sont de rigueur. De nouvelles actions communes pour renforcer la coopération
Entre Europe et États-Unis, ce n’est pas l’amour fou. Les divergences diplomatiques s’affichent
La politique française en Afrique selon Macron
L’Afrique revendique un pied d’égalité avec l’Europe
La Coopération structurée permanente prend son élan. Les quinze projets sélectionnés
La liste qui sera approuvée par les États membres ne devrait pas comporter de grand projet industriel comme l’A400M mais compte néanmoins quelques projets utiles au plan opérationnel comme capacitaire (crédit : DICOD / EMA – Archives B2 – l’arrivée du 12e A400M baptisée par les lances à incendie de la BA d’Orléans)
(B2 – EXCLUSIF) Le 11 décembre prochain, entre 23 et 25 gouvernements de l’Union européenne (1) devraient mettre leur signature au bas d’une décision destinée à lancer la « Coopération structurée permanente ». Autrement dit « l’Union européenne de sécurité et de défense » (2).
Cet acte, essentiellement politique – une union plus étroite en matière de défense avec l’engagement de faire davantage – va s’accompagner du lancement d’une quinzaine de projets capacitaires ou opérationnels, visant à renforcer la capacité des pays européens à agir de façon coordonnée (soit au sein de l’UE, soit au sein de l’OTAN, soit en multinational).
Une liste intéressante…
B2 a obtenu, en avant-première, la liste de ces projets, qui est à regarder avec attention. On n’y retrouve pas les projets actuels déjà lancés en multinational (satellite gouvernemental, ravitailleurs en vol, drone MALE) ou en binational (avion de combat franco-allemand, coopération navale belgo-néerlandaise ou terrestre germano-néerlandaise). Mais, il n’y a pas – comme on pouvait le craindre – que des projets « trop techno » ou d’une envergure réduite, qui n’auraient sans doute pas permis d’illustrer le coté « avant-garde » de la PESCO.
Quelques renforcements opérationnels
Certes ce n’est pas la révolution. Et il faut vraiment avoir l’esprit relativement tordu pour y voir les prémices potentiels de l’armée européenne. Mais on peut noter dans cette liste quelques projets particulièrement ambitieux d’un point de vue opérationnel : le commandement médical européen — qui pourrait être aux services de santé ce qu’est EATC pour l’aviation de transport — et le hub logistique (3), le dispositif de réaction de crises (CROC) ou de soutien aux secours de catastrophes.
… un zeste de partenariat
Un projet est particulièrement emblématique de la coopération civilo-militaire UE-OTAN puisqu’il figure à la fois sur la liste des projets PESCO et sur celle adoptée aujourd’hui des projets de coopération OTAN-UE, impliquant tant les États membres ou l’Alliance atlantique que la Commission européenne et l’Agence européenne de défense. Il fait, en effet, davantage intervenir des aspects réglementaires, économiques ou politiques que proprement techniques ou militaires.
… et une pincée de capacitaire
Au plan capacitaire, les projets de véhicules blindés, de drones sous-marins ou d’équipes cyber de réaction rapide peuvent être particulièrement remarqués.
A noter : les noms définitifs des projets comme les pays participants à tous les projets doivent encore être précisés. La liste publiée ci-jointe est extraite de l’article publié en avant-première sur le site de B2 Pro
(Nicolas Gros-Verheyde)
(1) 23 Etats membres ont déjà signé la notification commune, les gouvernements portugais et irlandais ont indiqué leur intention de rejoindre cette notification mais ils doivent encore obtenir l’accord de leur parlement respectif. De fait, tous les pays de l’Union européenne excepté le Danemark (en raison de son opt-out juridique), le Royaume-Uni (du fait du Brexit) et Malte auront ainsi marqué leur désir de faire partie de cette « union plus étroite » en matière de défense.
(2) Comme ses initiateurs l’avaient appelé dans les années 2000 (lire : L’Europe est capable de nous surprendre. Juncker) et comme continuent de l’appeler (à juste titre) différents responsables politiques tels J.-.C. Juncker l’actuel président de la Commission européenne, ou Ursula von der Leyen (lire : « Nous devons mettre les cartes sur table, penser et agir en Européens » (Ursula von der Leyen).
(3) Deux projets qui figuraient déjà dans la lettre franco-allemande signée à l’été 2016 par les ministres français (Jean-Yves Le Drian) et allemand (Ursula Von der Leyen)
NB : en cas de citation ou reprise partielle de cet article, merci de référencer B2 ou Bruxelles2. ainsi que le site.
Les forces spéciales d’intervention auront un secrétariat permanent à Europol
Le dispositif CBSD adopté. La touche finale…
A l’agenda de la ministérielle OTAN
L’amiral Casabianca, major général des armées ?
UE Afrique… ça coince
(B2) Entre l’Union européenne et l’Union africaine, loin des flonflons et des embrassades, le courant n’est pas rétabli apparemment. Et il « y a toujours des problèmes de clims » (pour paraphraser la formule du président français à Ouagadougou).
Quatre jours sans déclaration
Près de quatre jours après la fin du 5e sommet Europe – Afrique d’Abidjan, on a beau scruter : aucune déclaration commune à l’horizon. Cependant, l’habitude veut que ce type de documents soit préparé longtemps à l’avance par les différents sherpas des organisations et des pays membres. Ceux-ci étaient d’ailleurs à Abidjan en début de semaine dernière pour préparer les différents éléments. Mais rien n’y a fait. L’accord ne semble pas parfait …
Silence prudent
B2 a posé la question à plusieurs interlocuteurs : mur complet. C’est « en cours » répond l’un. « Voyez à Abidjan » indique un autre. Une « déclaration finale a été adoptée. Elle est en cours d’ajustement… de traduction » a affirmé, sans l’ombre d’un sourire Catherine Ray, la porte parole de la Haute représentante de l’Union, interrogée par nos soins au briefing de midi ce lundi (4 septembre). (écoutez ici)
Un problème politique
Pour un texte négocié, en amont, dans une seule langue (anglais), problème de traduction signifie « problème politique ». Apparemment les dirigeants africains sont légèrement agacés du ton comminatoire des Européens qui leur font régulièrement la leçon notamment sur l’immigration. A suivre …
(Nicolas Gros-Verheyde)
Carnet (04.12.2017). CBSD (adoption). Coopération PSDC-JAI. Collège de défense (budget). EUCAP Sahel Mali & EULEX Kosovo (recrutement). PESCO (Portugal). COPS (agenda). UE-Israël. Réunion UE-USA (Tillerson). Sanctions Russie (ExoMars). Task-force...
Quatre femmes à bord de la prochaine patrouille de SNLE
Quatre femmes à bord de la prochaine patrouille de SNLE
Des bourses à portée de main pour les jeunes chercheurs
(B2) Obtenir un financement pour sa recherche à finalité stratégique, c’est aujourd’hui possible. Un certain nombre de financements ont été mis en place par le ministère (français) de la Défense. Comment bénéficier d’une bourse, à quelles conditions ?… B2 vous dit (presque) tout.
Le Livre blanc de 2013 avait indiqué la nécessité de renforcer la « réflexion prospective » (1). La création d’un Pacte d’enseignement supérieur doté de 2,5 millions d’euros par an à destination du monde universitaire, financé par la DGRIS (la Direction générale des relations internationales et de la stratégie – ex DAS) est venue concrétiser cet objectif autour de deux maîtres mots : « Connaitre » et « Anticiper ». Destiné à jeter un pont entre le monde de la défense et le monde universitaire, ce pacte entend faciliter le développement et la régénération du vivier de chercheurs français sur les problématiques liées à la défense et à la sécurité.
Le programme « ambassadeur » : prochaine campagne début 2018
1° Que permet-il de financer : un séjour de 12 mois à l’étranger (hors zones jugées à risque par le ministère de la défense)
2° A qui s’adresse-t-il : aux post-doctorants
- français ou ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne, ayant soutenu avec succès sa thèse dans une université française (avec ou sans cotutelle, française ou étrangère) ou dans une université étrangère avec une cotutelle française, au cours des cinq dernières années au plus tard
- engagés sur un projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité et défense quelle que soit la discipline universitaire (géographie, économie, sciences politiques, droit etc…)
3° Quelles sont les modalités de mise en œuvre : le candidat (rattaché à un laboratoire universitaire français) propose un projet de recherche argumenté et justifié par l’intérêt scientifique (faisabilité auprès du laboratoire français) et un centre de recherche d’accueil à l’étranger qui valide le projet. Le laboratoire universitaire français reçoit une allocation pour salarier le post-doc pendant 12 mois pour une rémunération nette mensuelle minimum de 2300 €.
4° Combien d’allocations sont financées : deux au maximum par an.
Le programme « innovation » : prochaine campagne ouverte en mars 2018
1° Que permet-il de financer : une thèse de trois ans portant sur des enjeux de sécurité et de défense, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales (géographie, économie, sciences politiques, droit etc …) et comportant une prise de risque scientifique, soit sur le plan méthodologique (usage ou expérimentation de méthodes scientifiques innovantes, issues de différentes sciences humaines et sociales, voire empruntées à des sciences dites dures), soit sur le plan thématique (thématique de réflexion inédite dans le champs disciplinaire concerné, originalité du prisme scientifique choisi, renouvellement de la réflexion scientifique dans le domaine considéré).
2° A qui s’adresse-t-il : aux doctorants français ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne inscrit dans une université française (avec ou sans cotutelle, française ou étrangère) ou dans une université étrangère avec une cotutelle française. Seront privilégiés les étudiants en 1e année de thèse.
3° Quelles sont les modalités de mise en oeuvre : le laboratoire universitaire français reçoit une allocation pour salarier le doctorant pendant 3 ans pour une rémunération nette mensuelle minimum de 1550 €.
4° Combien de bourses sont financés : trois au maximum par an.
Le programme « thématique » : prochaine campagne ouverte en mars 2018
1° Que permet-il de financer : une thèse de trois ans portant sur des enjeux de sécurité et de défense, quelle que soit la discipline universitaire (géographie, économie, sciences politiques, droit etc.), relevant de l’une des thématiques spécifiques, appelées à changer chaque année (2).
2° A qui s’adresse-t-il : aux doctorants français ou ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne inscrit dans une université française (avec ou sans cotutelle, française ou étrangère) ou dans une université étrangère avec une cotutelle française. Seront privilégiés les étudiants en 1e année de thèse.
3° Quelles sont les modalités de mise en oeuvre : le laboratoire universitaire français reçoit une allocation pour salarier le doctorant pendant 3 ans pour une rémunération nette mensuelle minimum de 1550 €.
4° Combien de bourses sont financés : six au maximum par an.
Le programme « Aide à la mobilité »
1° Que permet-il de financer : le transport aérien ou ferroviaire pour présenter des communications à des colloques ou des séminaires nationaux ou internationaux (hors frais annexes : taxi, bus, métro…).
2° A qui s’adresse-t-il : aux jeunes chercheurs en sciences humaines rattachés à l’IRSEM.
3° Quels sont les domaines études ciblés : études des nouveaux conflits, pensée stratégique et nouveaux concepts, armement et prolifération, sécurité européenne et transatlantique, sécurités régionales comparées, défense et société, enjeux juridiques de le défense, histoire de la défense et de l’armement.
4° Quelles sont les modalités : déposer son dossier complet au moins deux mois avant le départ.
(Elena Barba)
Renseignements supplémentaires : retrouver toutes les informations utiles et dossiers de candidatures sur les sites de la DGRIS ou de l’IRSEM
La mise en place d’un label « Centre d’excellence »
Le ministère a décidé de sélectionner quelques établissements d’enseignement supérieur français et regroupements d’établissements, sur différents critères (excellence et innovation scientifique, impact et rayonnement des travaux, interdisciplinarité, insertion professionnelle). L’objectif est de soutenir des centres de recherche universitaires en pointe sur les questions de stratégie et de défense afin qu’ils soient reconnus et deviennent des références au niveau international.
Ces centres sont sélectionnés en deux phases. Premièrement, une phase de pré-sélection (qui a commencé en 2017) permettant de faire monter en puissance les centres académiques dans le domaine des études stratégiques en embauchant des jeunes chercheurs. Deuxièmement, la labellisation via un budget de 300.000 euros par an d’une durée de cinq ans renouvelable et permettant la création de nouveaux postes d’enseignants-chercheurs et la constitution d’une équipe de recherche de haut niveau.
(1) Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) avait mis en évidence des faiblesses —, « la recherche stratégique française souffre d’une masse critique insuffisante » – et préconisé une « démarche prospective de l’État [appuyée] sur une réflexion stratégique indépendante, pluridisciplinaire, originale intégrant la recherche universitaire ».
(2) A titre d’exemple, pour l’année universitaire 2015-2016 avaient été retenus les thèmes suivants : Russie, Afrique du Nord – Proche et Moyen Orient, Arctique, Afrique subsaharienne et australe, Asie centrale, Asie du Sud Est, BITD Russie, Chine, Inde, Cyber défense, Dissuasion nucléaire, Défense anti-missile, Marché international de l’armement, Démographie, Crises sanitaires mondiales, Questions religieuses, Prospective internationale de défense, Agrégats économiques de la BITD, Politiques de défense
Pages