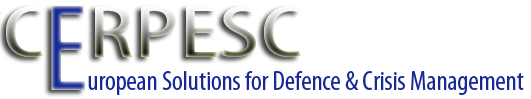You are here
Feed aggregator
Report: Vietnam's defence spending to cross $7bn mark by 2022
Deals this week: Newport News Shipbuilding, BAE Systems, Raytheon
A Tallinn, les ministres jouent à la guerre cyber hybride (V2)
(B2) C’était une petite première dont ne sont pas peu fiers les Estoniens. A Tallinn, lors de l’informelle défense, les 28 ministres de l’UE ont été invités à jouer leur propre rôle pour ce qui est le premier exercice cyber, mené au niveau stratégique.
Le scénario : une opération militaire de l’UE attaquée
Du scénario de « UE CYBRID 2017 », B2 a eu quelques éléments (même si les Européens ne veulent pas s’étendre, histoire de préserver les susceptibilités du grand voisin russe). Un scénario conçu sur des évènements en cascade touchant une opération militaire de l’UE déployée en mer. Cette attaque se poursuit durant un certain temps. Tout d’abord, on apprend le crash d’un drone d’observation. Puis c’est une attaque cyber sur un serveur informatique de l’état-major militaire qui dégrade non seulement les capacités locales de réaction mais son commandement et les liaisons Bruxelles – terrain. Un deuxième drone crashe… puis les évènements s’accélèrent.
Un malware et des fausses informations
On découvre un ‘malware’, un logiciel malveillant, qui a été introduit dans les systèmes européens. Et enfin c’est la communication avec les navires déployés qui se perd. Dans le même temps, l’Union doit faire face à une offensive, via les médias sociaux, de désinformation, voire de déstabilisation, avec diffusion de fausses nouvelles. Il importe donc de réagir vite pour informer la population.
Les 28 doivent réagir, tablette à l’appui
Une réunion ministérielle est convoquée pour décider des mesures à prendre face. La question qui se pose aux Européens est : que faire ? comment communiquer ? Comme dans la réalité, les informations remontent du terrain, données en partie par les médias, et les ministres sont invités à donner leur position. Pour cela, chaque délégation est a été munie d’une tablette. Et, face à un questionnaire à choix multiples, qui défile sur un écran tactile, chaque ministre doit indiquer sa position. Le tout dans un temps limité. Car, comme dans la réalité, l’important en cas d’attaque cyber et hybride est de réagir vite… et de garder la tête froide. A chaque étape, le résultat de la décision s’affiche en temps quasi-réel, sous la direction de Jonatan Vseviov, le secrétaire permanent du ministère estonien de la Défense, qui joue le rôle du chef d’orchestre.
Associer le maximum d’acteurs
Hors des ministres, d’autres structures de l’UE sont impliquées : le Service diplomatique européen (SEAE), l’Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA, basée à Heraklion en Grèce) et l’Agence européenne de défense (basée à Bruxelles), tout comme l’OTAN. Ce qui est à la fois un atout – bénéficier de l’avis des experts – mais complique aussi la donne de décision (comme dans la réalité).
Huiler les procédures
L’objectif de l’exercice est tout d’abord de « prendre conscience de la situation » comme l’explique un expert du dossier, puis d’« assurer la gestion des crises » comme la prise de position publique (NB : la communication stratégique) entre tous les États membres, en bref « huiler les procédures » pour arriver à une ligne directrice politique commune face à un cas de cyberattaque qui menace les structures militaires de l’Union européenne.
Les ministres se sont pris au jeu
Un peu sceptiques au départ, « les ministres se sont pris au jeu » en fait. Et, durant la bonne heure qu’a duré l’exercice (temps d’explication inclus), chacun des participants a été amené à réfléchir à la nécessité de prendre des décisions, rapides, stratégiques, en consultant à la fois sa capitale mais en arrivant surtout à une position commune, pour éviter de donner à « l’assaillant » la victoire ou le sentiment de la victoire.
Une différence d’appréciation au fil de l’exercice
Au début de l’exercice, lorsque les premières nouvelles sont arrivées, « tout le monde était presque d’accord pour avoir une communication aussi large que possible, factuelle sur les évènements » raconte à B2, le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput. « Mais au fur et à mesure que tombaient les nouvelles, cela est devenu plus difficile, la plupart [des États] se fermaient ». Ce qui montre toute la difficulté de ce type d’attaque. « La défense aime bien apposer un « classified defence » sur tous ces documents pour empêcher toute information », précise un expert du dossier.
Des questions qui se posent
L’exercice a entraîné aussi quelques questions : à quel moment peut-on parler d’une attaque, d’un conflit, au sens international du terme, qui provoquerait la mise en place des procédures de solidarité (clause d’assistance mutuelle type article 42.7 au niveau de l’UE ou de défense collective article 5 pour l’OTAN) ? Quels outils dispose (ou doit se doter) l’Union européenne pour faire face à de telles attaques ? Comment coopérer, de façon pratique, et politique avec l’OTAN, qui parait davantage « armée » pour faire face à des cyberattaques sur ses structures de défense ? « Au niveau de l’Otan, il y a des procédures. Au niveau de l’UE, c’est moins développé, il y a encore des progrès à faire » précise Steven Vandeput.
Le cyber ne connait pas de frontières
L’exercice montre que « différents problèmes ‘techniques’ peuvent se transformer rapidement en des questions nécessitant une orientation politique », a résumé ensuite le ministre estonien de la Défense Jüri Luik. « Le monde cybernétique et les menaces cybernétiques ne connaissent pas de limites nationales ou d’obstacles entre les organisations ».
Une communauté de réaction OTAN – UE
Il est donc « important d’effectuer ce type d’exercices conjoints, entre les États membres de l’Union européenne ainsi que l’UE et l’OTAN. Nous devons échanger des informations et avoir une compréhension commune, afin d’assurer une meilleure préparation pour faire face aux menaces cybernétiques ». NB : Une réplique de cet exercice devrait se tenir au niveau de l’OTAN en octobre, où l’Union européenne sera invitée.
(Nicolas Gros-Verheyde, à Tallinn)
Le souvenir d’il y a dix ans
Les Estoniens sont particulièrement sensibilisés aux attaques cyber à relents hybrides. Il y a quelques dix ans, le 27 avril 2007 exactement, la petite république balte subissait une attaque informatique d’ampleur (organisée depuis la Russie) qui a déstabilisé gravement son système bancaire. L’attaque s’est accompagnée de répliques plus ou moins importantes dans les mois suivants, accompagnées de diffusion de fausses informations sur une possible dévaluation de la monnaie estonienne qui ont mis l’Estonie dans une situation plus qu’inconfortable.
mis à jour à 16h45 avec des éléments plus détaillés sur le scénario, le jeu entre les ministres et les questions posées
Dspnor Receives Orders from European Navies and is to Showcase New Software at DSEI
F-16 Belges. La France reste dans la course mais hors de l’appel d’offres (V3)
Le Rafale reste bien dans la compétition pour le F-16 Belge (photo : un Rafale engagé dans l’opération Chammal / crédit : DICOD / EMA)
(B2) La ministre française des Armées, Florence Parly, l’a confirmé à Tallinn, en marge de la réunion informelle des ministres de la défense de l’UE (en répondant à une question de notre collègue de l’AFP) : « le gouvernement français fera bien une proposition à la Belgique pour le renouvellement de sa flotte d’avions de combat. » Elle semble démentir ainsi une information donnée par la Libre Belgique qui indiquait que Dassault avait décidé de ne pas déposer d’offre pour le remplaçant du F-16 Belge.
Une offre de gouvernement à gouvernement
De fait, le démenti n’est que partiel car comme l’écrit notre confrère Jean Do Merchet dans Secret Défense, la France se retire bien de l’appel d’offres, jugé trop favorable au F-35 américain. Mais elle va déposer une offre « de gouvernement à gouvernement » (un peu comme celui conclu avec l’Inde), offrant non pas le Rafale mais le Rafale + (la version suivante), avec une proposition industrielle. Cet accord comprendra « un volet de compensations industrielles (offset) et de coopération militaire étroite dans le cadre de l’Europe de la Défense ».
Un partenariat allant au-delà des équipements
L’ambition française est, en effet, comme l’a expliqué Florence Parly, la mise en place d’un « partenariat approfondi » entre nos deux pays. Ce partenariat structurant comprendrait non seulement la fourniture de l’avion de combat Rafale, mais aussi une « coopération approfondie entre nos deux armées de l’air dans les domaines opérationnels, de formation et de soutien, ainsi qu’une coopération industrielle et technique impliquant des entreprises des deux pays » indique le communiqué de la ministre des armées. Un partenariat qui irait donc « bien au-delà des seuls équipements militaires [et] consoliderait la relation ancienne et profonde » entre les deux pays, et contribuerait « au renforcement de l’Europe de la Défense et de son autonomie stratégique, à une période où celle-ci est plus que jamais nécessaire ».
Deux compétiteurs seulement
Boeing et Saab (Gripen) ayant déjà jeté le gant, il ne restera donc que plus deux avions en lice pour la première phase de l’appel d’offres de la Belgique (qui se termine ce soir) : le F-35 américain (qui a la préférence de l’armée de l’air belge) et l’Eurofighter/Typhoon (défendu par les Britanniques).
Des Belges interloqués
Interrogé par B2, en marge de la réunion, le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput, s’est retranché derrière cette procédure : « On ne peut pas parler d’une procédure dont la première phase se termine ce soir, avant que cette première phase soit terminée » a-t-il indiqué, visiblement agacé de cette position française intempestive. Il n’a pas voulu d’autres détails se contentant de dire qu’il avait « vu et discuté avec ma collègue française ».
(Nicolas Gros-Verheyde)
Mis à jour avec la réaction belge et le communiqué officiel français
Rafale : la France va proposer un accord gouvernemental à la Belgique
Rafale : la France va proposer un accord gouvernemental à la Belgique
Carnet (07.09.2017). Fonds défense (réunion). Cops (Turquie). Budget français (économie). Italie-France (rapprochement). Royaume-Uni (renaissance navale). Belgique (Dassault). Franco-Britannique (exercices). Belgique (Minusma). Corée du Nord (nucléaire...
UK unveils new shipbuilding strategy and sets out plan for new Type 31e frigates
Canadian Navy to integrate ViaSat's Link 16 system on Halifax-class frigates
Lockheed Martin's AOEW system passes US Navy preliminary design review
Florence Parly réussit son examen de passage
Florence Parly s’exprimant devant les participants de l’université d’été de la défense (crédit : DICOD)
(B2) Pour Florence Parly, qui s’exprimait en clôture de l’université d’été de la défense à Toulon, ce mardi (5 septembre), c’était un peu à la fois l’examen de rentrée et l’examen de passage.
La nouvelle nommée à la Défense, un peu par hasard, en juin, était restée très discrète jusqu’ici. On la comprend. La démission impromptue de Sylvie Goulard (après à peine quelques semaines de mandat), la réduction du budget de défense, la prise de bec publique entre le président de la République et son chef d’état-major Pierre de Villiers, qui s’achève logiquement par la démission du second, et une crise de confiance dans les armées n’étaient pas vraiment faites pour encourager la nouvelle venue à s’exprimer publiquement. Inutile de préciser que dans le milieu des armées, la grogne était forte contre la remontrance publique contre leur ancien chef, perçu comme un affront personnel par chaque haut gradé. Ses propos étaient donc très attendus.
Durant cette université d’été, la parole de la ministre s’est affirmée au fil des interventions. Et son discours de clôture était charpenté, rempli d’une détermination, avec des annonces claires.
« Le Président m’a fixé un cap clair, des échéances précises et des moyens nouveaux pour faire face à ces défis. Je suis déterminée à remplir cette mission, et je sais que l’ensemble de la communauté de défense aura à cœur de se mobiliser autour de ces objectifs. »
Sans rien renier de la discipline gouvernementale, en prenant bien soin de s’inscrire à chaque fois dans les pas du Président de la république, elle a tenu bon aussi sur les besoins des armées, les engagements financiers nécessaires pour les années futures, parlant d’un « tournant historique ».
« Pour mettre en œuvre cette nouvelle vision, les armées disposeront de moyens accrus. […] Dès 2018, les crédits budgétaires de la mission Défense augmenteront de 1,8 milliards d’euros. […] C’est la première étape vers l’objectif fixé par le Président de la République d’augmentation de l’effort de défense à 2% du PIB soit 50 milliards d’euros en 2025, à périmètre constant (*). […] Le rythme de cette hausse se poursuivra avec une augmentation de 1,6 milliard d’euros par an pendant toute la durée du quinquennat. Ce tournant est historique. Depuis quarante ans, jamais effort financier en faveur des armées n’aura été aussi important».
Voulant clôturer ce chapitre douloureux, elle a aussi voulu s’éloigner du terreau financier (qui lui est coutumier) pour s’engager plus en avant sur le format de l’armée du futur : la décision officielle d’armer les drones est un acte particulièrement majeur pour la doctrine française (même s’il était en soi attendu). La révision de l’opération Sentinelle et l’adaptation du dispositif au Levant, ainsi que sa volonté réaffirmée de défendre l’Europe de la défense, témoignent aussi d’une conscience opérationnelle et politique aiguisée.
L’attitude stricte de la ministre, sans sourire complice auquel nous avaient habitué certaines de ses homologues européennes, complétait un tableau. On retrouvait comme un certain mimétisme avec l’Allemande Ursula von der Leyen, avec qui Florence Parly va travailler de façon régulière (c’est sa feuille de route) ou avec une illustre prédécesseure à ce poste, Michèle Alliot Marie.
L’avenir dira si dans l’esprit et le cœur des militaires, elle pourra remplacer MAM ou Jean-Yves Le Drian. La barre est placée haut. Mais assurément, dans le grand hangar du BPC Mistral, ancré à quai dans la base navale de Toulon, devant un aéropage composé des gens qui ‘comptent’ dans le monde de la défense (les militaires, les industriels, les chercheurs, les journalistes), Florence Parly a franchi la première marche.
(Nicolas Gros-Verheyde, à Toulon, sur le BPC Mistral)
(*) Le mot « périmètre constant » est important. Et la ministre a insisté sur ce point. Cela pourrait signifier notamment que le financement du nouveau service national se fera en plus de ce montant.
Télécharger son discours
Xavier Bertrand : « Il est urgent de réarmer la France »
Xavier Bertrand : « Il est urgent de réarmer la France »
SENER Receives 'The European' Award for its Innovation and Distinction
La demande en référé d’Argus securité rejetée
Le ministère des armées lance une mission sur le MCO dans l’aéronautique
Le ministère des armées lance une mission sur le MCO dans l’aéronautique
« J’ai décidé de lancer le processus d’armement de nos drones »
« J’ai décidé de lancer le processus d’armement de nos drones »
Pages